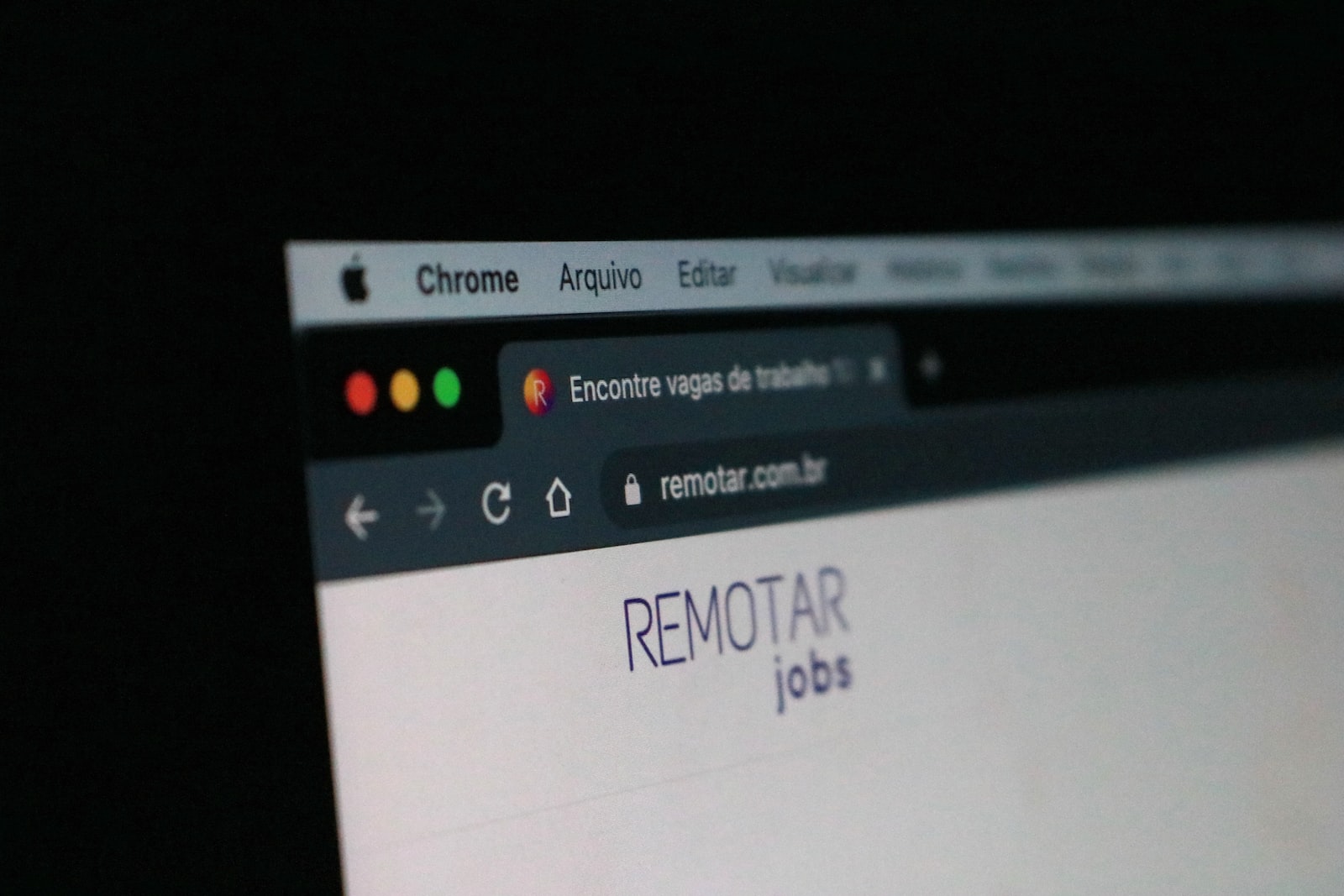Histoire de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Cet article donne un bref aperçu de l’histoire de l’École polytechnique fédérale au XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Il ne s’agit en aucun cas d’une étude historique exhaustive. Vous trouverez plus d’informations sur les 150 premières années de l’EPF dans le livre très lisible Die Zukunftsmaschine. Konjunkturen der ETH Zürich 1855 – 2005 par D Gugerli, P Kupper et D Speich, Chronos-Verlag, Zürich, 2005.
Les origines de l’École polytechnique fédérale de Zurich sont étroitement liées à la fondation de la Suisse moderne en tant qu’État fédéral en 1848. La Confédération suisse a été fondée en 1291, bien qu’il faille dire que les trois cantons fondateurs, Uri, Schwyz et Unterwald, n’ont fait que renouveler une confédération déjà existante. Sans entrer dans les détails, les origines de la Suisse sont souvent glorifiées par le grand public. Il suffit de dire que l’ancienne confédération n’avait pas grand-chose en commun avec la Suisse moderne. Par exemple, la réforme a provoqué un clivage entre les cantons catholiques et protestants. Les pères fondateurs de la Suisse moderne et, par extension, de l’Ecole polytechnique, en ont encore ressenti les conséquences.
À la suite de la campagne helvétique de Napoléon, la République helvétique a remplacé l’ancienne Confédération en 1798.
Cette république était basée sur le modèle français et ne convenait pas du tout aux Suisses. Après cinq ans de conflit, Napoléon a reconstitué une confédération, mais il a limité les privilèges des classes supérieures [4, p. 115-116]. Cependant, après la défaite de Napoléon, les Suisses fondèrent une nouvelle Confédération, qui comprenait 22 cantons et était basée sur le modèle pré-napoléonien.
Le plus important est que les cantons se sont vus accorder la pleine souveraineté et que les classes dominantes ont de nouveau bénéficié d’un statut privilégié. Par ailleurs, la Suisse a choisi la neutralité à la même époque, en 1815. Si la Confédération est devenue neutre en 1515, c’était plus par nécessité que par choix car les conflits entre les différents cantons ne permettaient pas d’engagement militaire extérieur. Cependant, certains cantons ont signé des traités de capitulation avec des puissances européennes et les mercenaires suisses ont continué à se battre dans toute l’Europe.
De retour dans la Confédération suisse, la « Restauration » (1814-1830) a été suivie d’une période de régénération.
Des partis et des sociétés libérales sont fondés, le peuple réclame la souveraineté populaire, la démocratie représentative et la séparation de l’Église et de l’État. En outre, les groupes libéraux voulaient améliorer l’éducation au niveau scolaire et universitaire, et introduire une monnaie uniforme – les différentes monnaies entravaient la croissance économique à une époque où l’industrie textile en particulier se développait rapidement [cf. 4, p. 121-122].
Ces développements ont conduit à un clivage entre les cantons libéraux, majoritairement urbains et protestants, et les cantons conservateurs, majoritairement ruraux et catholiques. Les tensions entre les cantons ont donné naissance à deux « Freischarenzüge » en 1844 et 1845, respectivement : Des troupes volontaires de libéraux radicaux tentèrent de renverser le gouvernement catholique du canton de Lucerne et exigèrent que les jésuites soient bannis du pays. Ces demandes ont été déclenchées par le fait que Lucerne a nommé des jésuites pour enseigner dans les écoles cantonales dans les années 1840.
Les troupes radicales de la Freischarenzüge ont été vaincues, mais les cantons catholiques et conservateurs de Fribourg, Lucerne, Schwyz, Unterwald, Uri, Valais et Zoug ont alors uni leurs forces dans un « Sonderbund » (« Alliance séparée ») pour protéger leurs intérêts. Cependant, cette alliance a violé le traité fédéral de 1815. Après des discussions infructueuses, le Tagsatzung, le conseil législatif et exécutif suisse à prédominance libérale, a décidé de dissoudre l’alliance et de réviser le traité fédéral [2, p. 658-659]. En octobre 1847, la Tagsatzung donne au général Henri Dufour, commandant suprême des troupes fédérales, le pouvoir de dissoudre le Sonderbund par la force. La campagne dura moins d’un mois et fut le dernier conflit armé sur le territoire suisse.
Après de nombreuses discussions, la Constitution fédérale suisse est adoptée le 12 septembre 1848, et la Suisse devient ainsi un État fédéral. Au cours des négociations, la religion et les langues ont fait l’objet d’un conflit particulier. À la suite de la Constitution, les cantons ont perdu une partie de leur souveraineté – par exemple, les coutumes entre cantons ont été abolies ; les coutumes fédérales, une monnaie uniforme et le service postal ont été introduits. Toutefois, les cantons conservent leur autorité dans un certain nombre de domaines, notamment l’éducation, les impôts directs, la protection sociale, la police et les infrastructures régionales. La Confédération, quant à elle, est responsable de toutes les questions de nature fédérale, comme les affaires étrangères et la défense.
Ces compétences sont détaillées dans les articles 1 à 20 de la Constitution. L’article 22, en revanche, concerne l’enseignement supérieur au niveau fédéral : La Confédération est autorisée à créer une université et une école polytechnique » [cité dans 5, p. 21].